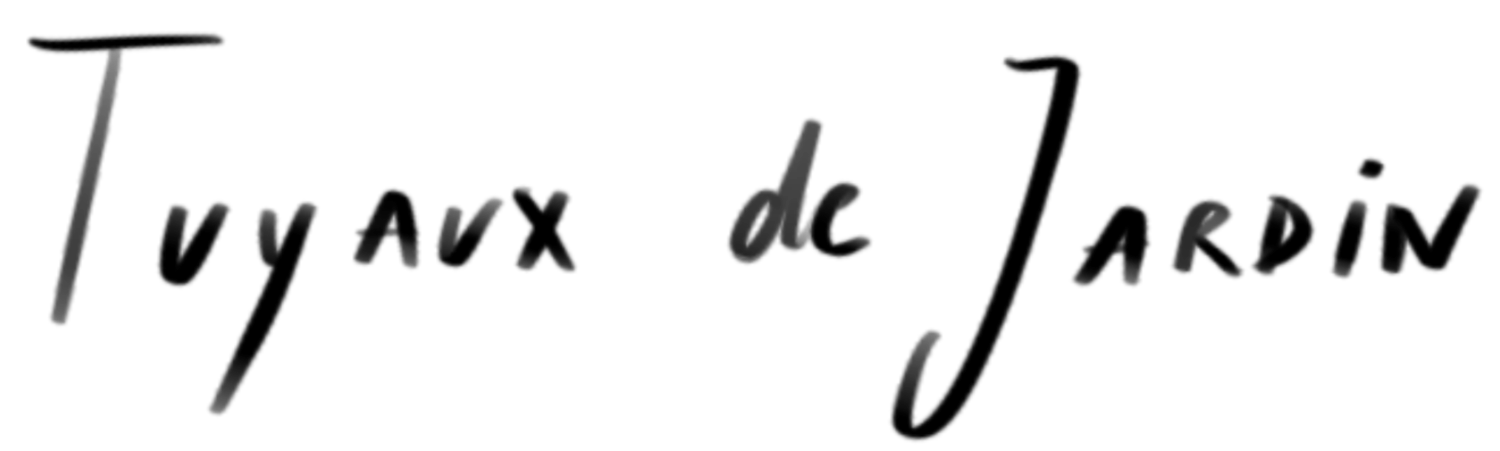Le cardon, aussi beau que bon
Si vous pensez qu’en novembre votre potager est en bout de souffle, voici un légume qui attend ce moment pour devenir comestible! Le cardon descend d’une sorte de chardon sauvage très épineux, natif des régions méditerranéennes: Cynara cardunculus. Il n’y a pas que les ânes qui l’appréciaient: il fut domestiqué il y a belle lurette. Certaines sélections furent poursuivies pour obtenir de gros boutons floraux bien tendres: ce sont nos artichauts, Cynara cardunculus var. scolymus. Une autre voie visait plutôt l’obtention de côtes larges et savoureuses: ce sont les cardons, Cynara cardunculus var. altilis.
Cette plante fut cultivée comme légume dès l’Antiquité, très présente dans les cuisines grecques, romaines et persanes. On trouvait le cardon dans les potagers européens jusqu’à la fin du XIXème siècle mais son usage recula progressivement. Ce n’est plus que dans les potagers qui ont maintenu une longue tradition qu’on le trouve aujourd’hui. Il reste cependant présent dans des plats traditionnels régionaux, principalement en Italie, en Espagne ainsi qu’en Afrique du nord. On le consomme à Noël à Lyon et à Genève.
Tout comme l’artichaut, le cardon produit des boutons floraux comestibles, mais de taille nettement plus petite. Ceux-ci doivent être récoltés au printemps, avant que la fleur ne s’ouvre.
Ce sont toutefois surtout les cardes ou côtes des grandes feuilles de la plante qui nous intéressent.
Telles quelles, ces côtes sont amères, raison pour laquelle on doit passer par une étape intermédiaire avant de les manger: le blanchiment. Trois semaines à un mois à l’abri de la lumière sont nécessaires pour attendrir les cardes.
Pour ce faire, il y a trois méthodes principales: le butage, l’empaquetage ou le déterrage. En Espagne, les plants sont butés de façon à blanchir les tiges sous terre à la manière des asperges blanches. Si l’on possède un cellier ou une cave à légumes (ce qu’offraient les potagers anciens), on peut déterrer toute la plante avec sa motte et l’installer à l’intérieur pour la durée de l’hiver. Le plus simple est cependant de laisser les plants en terre. Après avoir retiré les feuilles extérieures abîmées, on ligote le reste avec du carton, du journal ou de la jute. On coupe la botte quand on veut la consommer, ce qui peut se faire de manière échelonnée de novembre à mars.
Pour préparer les cardes, il faut les peler pour ne garder que la partie intérieure blanche. L’opération est forcément plus agréable avec les variétés peu épineuses. On plonge immédiatement les morceaux nettoyés dans de l’eau vinaigrée ou citronnée pour éviter qu’ils ne brunissent.
Il ne reste plus qu’à trouver une recette à votre goût avec l’aide d’Internet: gratins, potages, tajines, à la Lyonnaise, à la moëlle…
Les cardons doivent généralement cuire longtemps pour être tendres. La conservation en bocaux contribue à les attendrir.
Si la production maison de cette délicatesse culinaire vous paraît fastidieuse (c’est mon cas), peut-être pourrez-vous être convaincus d’introduire le cardon dans vos parterres. A mon sens, c’est une des vivaces les plus majestueuses du jardin. Sur des plants en place depuis quelques années, de grandes feuilles découpées, très argentées, se déploient dès l’automne. Elles passent bien l’hiver, sauf si le gel est vraiment intense.
Positionné à l’arrière d’un parterre, le cardon remplit l’espace dès mars/avril et crée un fonds intéressant pour les floraisons printanières, alliums, tulipes, brunneras, géraniums vivaces. Dès mai, des tiges s’élèvent jusqu’à 2 mètres de haut, portant de nombreux boutons floraux. En juillet, les boutons s’ouvrent, révélant de grands coussinets violets.
Le détail de la fleur épanouie est étonnant: un hérisson filaments violets qui sont autant de fleurs tubulées. Elles sont très mellifères et attirent un grand nombre d’abeilles. En fin de saison, les petits artichauts sèchent, mais restent très décoratifs pour l’hiver si on souhaite les laisser en place. Je constate toutefois que les tiges sont si hautes et si lourdes de fleurs que les grands vents d’automne ont tendance à les renverser. Je les coupe et les pends à l’envers pour les sécher.
Frais ou secs, en bouton ou en fleur, les cardons font merveille dans les bouquets. Ils donnent de la hauteur à cette composition de fin d’été en compagnie de hortensias, de dahlias et de buddleias.Les grandes feuilles grises sont des feuilles de chou marin.
La fleur séchée est tout aussi intéressante et donne de l’impact aux bouquets secs. Il suffit de retirer les filaments séchés pour mettre en valeur le foin doré au coeur de la fleur.
Il existe un choix limité de cultivars du cardon. Leurs noms sont aussi désuets que le légume lui-même. Voici les principaux.
‘Plein Blanc Inerme’ a le mérite de ne pas avoir d’épines et d’offrir des côtes larges, un avantage pour la préparation.
‘Epineux de Vaulx-en-Velin’ a un feuillage finement découpé, argenté et très épineux mais très décoratif. Il supporte les hivers rigoureux.
‘Cardon de Plainpalais’ est bleuté et également épineux avec une bonne résistance au froid.
‘Argenté de Tours’ , très décoratif et vigoureux, a un feuillage très argenté et peu d’épines.
On peut y ajouter divers cultivars italiens, moins rustiques cependant.
Les plantes s’obtiennent par semis en godets au printemps. Les semences ont la taille des graines de tournesol. Les plantules se mettent en place une fois la terre bien réchauffée. On pourra ensuite prélever des rejets au pied des plantes établies.
Un plant de cardon est un bon investissement: il fait des petits et se maintient sans soucis des années durant.